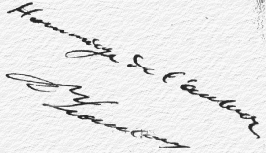
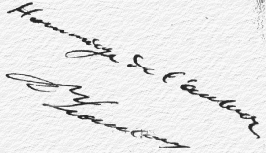
Avant les origines était déjà un Génie tout puissant. Il n'avait pas eu de commencement et menaçait de n'avoir pas de fin. On aurait pu le croire vieux, parce qu'il était triste ; en réalité, il n'avait pas d'âge.
La chair de son corps n'était pas faite de cette matière animée et changeante qui est la joie de nos sens, quand elle n'en est pas la douleur. C'était quelque chose d'immobile et de glacé, d'indéfiniment uniforme, une substance partout semblable à elle-même, sans détails et sans accidents.
Rien n'était en dehors de ce néant, et cependant cette stérile immobilité qui paraissait éternelle n'était que la prison de l'immense défilé des êtres et des choses. Ce cadavre recelait tous les germes de vie à venir ; ce tombeau contenait dans sa nuit silencieuse toute la lumière et toute la sonorité de l'univers. Cette durée était le Temps.
Alors, comme à présent, le Temps était une force, c'est-à-dire l'attente d'un mouvement, une tension, une possibilité, une tendance qui pouvait se réaliser en s'évanouissant ou persister à la condition de ne pas se révéler. Pour se manifester, il fallait, chose étrange, que ce fantôme se détruisît lui-même, car il était le résultat d'un ensemble de forces toutes égales entre elles, se neutralisant parfaitement dans un univers réduit à un point.
Un jour le Temps cessa d'être seul et commença de vieillir. Comment se produisit cet événement ? - Qui le dira jamais ? - Un léger déséquilibre insignifiant au début, puis grossissant en avalanche, se fit dans cet immense équilibre. Une force concourante prit - Ô miracle ! - une supériorité sur la force antagoniste. La porte de la prison s'entrouvrit à peine, mais un, puis deux, puis cent, puis mille prisonniers coururent à la liberté. Le premier instant s'opposa vainement à la première évasion, et l'évolution, mère des choses, des hommes et des idées commença, déroulant sa longue suite de projections toujours nouvelles dans un déterminisme imprévisible. Quelque chose de nouveau venait d'apparaître. Ce n'était plus seulement de la force, une cause sans effet, mais un effet qui pouvait à son tour devenir une cause. Ce n'était plus le maintien, la conversation, l'immobilité, mais une réalité toujours mouvante, un élan toujours nouveau.
Le mouvement venait de naître, et déjà il luttait, car il dressait rapidement contre la Chimie du Temps la Physique de l'Espace. La matière déchirée par les deux rivaux, n'était qu'une pauvre chose inerte dont les variations reflétaient les épisodes de cette lutte grandiose.
Avec l'Espace, l'unité était devenue le nombre, le simple le complexe, l'homogène l'hétérogène.
Mais le temps cernait la matière et croyait la garder. L'Espace s'insinuait subtilement en elle ; il la gonflait, la disloquait, l'émiettait, en faisait des poussières de mondes et déchiquetait les siècles.
Alors le Temps jeta les astres contre les astres. Il espérait dans cette effroyable confusion retrouver la stérilité de jadis, gage de son éternité. Sous la brutale poussée, les pesantes machines roulèrent vertigineusement. Mais les forces du Temps fondaient dans la vitesse accrue des gravitations. Au lieu du chaos, la puissante harmonie du mouvement groupait les systèmes, ordonnait les étoiles, réchauffait les planètes aux rayonnements des soleils, organisait l'univers. Les mondes s'enlaçaient et mêlaient leurs trajectoires irrésistibles, se rapprochaient sans se heurter, s'abandonnaient sans s'oublier, unis par le lien invisible et souple que l'Espace jetait entre eux. On eut dit qu'une Pensée animait l'univers, car de ces mondes ardents naissaient sans cesse d'autres mondes auxquels l'Espace servait inlassablement de berceau.
Humilié, le Temps tourna son irritation contre l'infiniment petit. Sous sa main impitoyable, les molécules s'écrasèrent et se confondirent ; mais elles n'étaient déjà plus que du mouvement qui échappait à l'étreinte, comme l'oiseau à la main de l'oiseleur inattentif. La matière trahissait son maître et s'écoulait en mouvement.
Alors, le mauvais Génie s'écria : "Je veux créer une puissance de mort qui, après avoir détruit la matière transfuge se détruira elle-même" - Et le bouillonnement de la Vie éclata dans la matière humide. Mais voici que la Vie rendait à l'Espace cette matière inerte transformée en gerbes de mouvement.
Dans sa colère stupide, le Temps, créateur inconscient de ces prodiges imposa à la Vie la maladie et la douleur.
Se croyant éternel, il avait oublié le passé ; il ne savait donc pas prévoir.
De la maladie qui est une dissociation incomplète de l'être vivant, jaillirent brusquement les sexes vainqueurs de la mort, et de la douleur qui est l'écrasement de l'instinct se dégagea lentement la conscience, matrice de la Pensée. L'être vivant connut alors l'Espace qui l'attirait ; il tendit vers lui transformant en effort la souffrance imposée par le Temps.
Un jour vint où l'Espace put enfin se contempler dans un petit amas de matière grise, ravagée comme un jardin après l'orage. Alors le Temps compris que sa fin approchait car son rival triomphant venait d'incliner son immensité sur le cerveau d'un enfant nouveau-né...
Maintenant les heures s'épuisaient, joyeuses ou funèbres, scandées par le chant des nourrices ou la plainte des mourants. Mais l'homme grandissait.
Soudain un froissement d'ailes anima les ruines silencieuses du Temps : la matière s'élevait à la Vie ; la Vie plus libre fuyait vers la Pensée et la Nature entière fondait dans la DOUBLE ENVOLEE qui montait en plein ciel.
C'est ainsi que s'est imposée à mon esprit l'idée d'évolution, immolation de plus en plus rapide du Temps sur l'autel de la Vie. La Biologie nous est apparue comme le pont nécessaire et mobile jeté entre la matière, esclave du Temps, et la Pensée, sœur de l'Espace. N'en avons-nous pas la preuve dans ce fait qu'un objet ne peut être conçu que par analogie avec notre propre corps, comme si l'unité et l'identité de l'un nous aidaient à saisir l'unité et l'identité de l'autre ?
On ne peut donc essayer une explication de l'univers, si timide soit-elle, qu'à la condition d'examiner brièvement la base des doctrines biologiques pour en éprouver la solidité. Laissant de côté les théories animistes et vitalistes qui paraissent tourner le problème sans le résoudre, nous envisagerons rapidement du point de vue philosophique la doctrine cinétique et la doctrine énergétique qui sont le plus généralement acceptées.
Les partisans de la première prétendent nous démontrer que la vie est un simple phénomène chimique. Comment s'y prennent-ils ? Très simplement, grâce à l'emploi d'un langage objectif soigneusement débarrassé de tous les termes vagues et trompeurs qui encombrent les autres doctrines.
En effet, qu'observons-nous autour de nous ? - Des forces ? - Non pas, car une force est pure abstraction. Nous ne voyons que des mouvements et chacun de ces mouvements provenant d'un mouvement antérieur engendre à son tour un autre mouvement. Il ne peut y avoir de commencement absolu dans cette chaîne sans fin. Mais le premier mouvement, celui qui ouvre la série, d'où vient-il ? Les mécanistes ne vous répondront pas. Vous insistez ? Ils vous conseilleront alors, non sans aigreur, de vous adresser à quelque théologien qui a seul qualité pour se mettre délibérément hors de la Science.
Restons donc sur le terrain des réalités, et reprenons la formule de Le Dantec : la Vie est un phénomène chimique.
Après une déclaration de cette netteté, il faut nous attendre à voir résoudre la vie par une simple équation. Le Dantec, un des plus célèbres parmi les mécanistes, n'a garde d'y manquer.
Un phénomène chimique modifie profondément la nature d'un corps. La matière inerte se transformant en matière vivante ne répond-elle pas très exactement à cette condition ? Assimilation deviendra donc synonyme de vie.
Servi par une logique rigoureuse, et par un esprit critique aiguisé, Le Dantec nous prend par la main et ne nous abandonne plus. C'est un guide sûr qui connaît son chemin et qui évite soigneusement tout écart. Il nous devance et nous éclaire ; quand un obstacle se trouve sous ses pas, il le déplace du pied, parfois il l'émiette. Cependant le sentier est rocailleux ; le terrain trop dur devient douloureux à nos pieds fatigués. La Science n'a cependant pas que des landes ; voici une oasis délicieuse et où il ferait bon s'asseoir et peut-être rêver. Déjà n'y tenant plus nous faisons mine d'y courir. Mais le guide sévère veille sur tous nos mouvements. D'un regard glacé, il nous cloue sur place et nous donne à méditer l'équation de la Vie élémentaire.
Toute substance qui, entrant en réaction avec d'autres substances, présente le pouvoir assimilateur, est douée de vie. Une telle substance peut aussi posséder d'autres qualités, mais ces qualités très secondaires, telles que le mouvement, la forme spécifique, le mode d'accroissement, elle n'est pas seule à les posséder, et, nous avons grand tort philosophiquement d'y attacher quelque importance. Les colloïdes et les cristaux sont sous ce rapport aussi bien partagés que les protoplasmas.
L'élément primordial de la Matière vivante est la cellule ; les phénomènes physiques d'échanges entre la cellule et son milieu, ainsi que les phénomènes intracellulaires (molaire et moléculaire) nous donnent de la Biologie une explication satisfaisante.
Cependant quelques personnes inquiètes ou trop exigeantes demandent mieux.
Voyons ce qui se passe dans une cellule se conformant à la théorie mécaniste.
Soit une cellule C dans un espace clos riche en aliments. Un courant alimentaire de vitesse V, s'établit entre la cellule et son milieu, tandis qu'un courant résiduel de vitesse V' sort de la cellule C. - Ce courant V' présentera une vitesse moindre que V puisqu'une partie de V est utilisée in situ par C, pour accroître sa réserve de mouvement, c'est-à-dire sa substance. Ces deux courants de sens opposés par rapport à C, l'un afférent, l'autre efférent, sont donc le résultat d'un ensemble de réactions, dont la conclusion sera une réaction d'assimilation. Mais pourquoi pas de désassimilation ? - Songez que si l'assimilation est toute la Vie, il faut bien cependant que dans les résidus de cette réaction vitale, nous trouvions non seulement les substances inutilisables, mais encore les substances de réserve destinées à être consommées ultérieurement et qui sont spécifiques.
Pouvons-nous considérer la réaction de désassimilation comme une réaction non biologique, ainsi que le fait Le Dantec ; comme une réaction exclusivement destructive ? - Nous serions tout au contraire tentés d'y voir la note essentielle de l'activité des protoplasmas, puisqu'elle est la condition de l'acte fonctionnel. Quand la cellule transforme une substance de réserve en une substance vivante, ce phénomène paraît solidaire d'une autre transformation toute aussi importante : celle d'une infime quantité de substance vivante en une certaine quantité de substance de réserve spécifique. On ne peut même pas dire qu'il y ait réversibilité chimique suivant la formule générale A+B=C et C=A+B. Le choix que fait la cellule dépasse sensiblement la simplicité d'une équation. L'équation de Le Dantec ne prendra sa vraie signification que si on la fait suivre de ces mots : partout où existe un corps vivant, il y a de la vie.
Ecoutez ce que dit à ce propos F. Houssay dans son livre sur la Science et les Sciences Naturelles :
On peut aussi reproduire le feu par germe, c'est-à-dire prendre dans sa masse une petite partie convenablement choisie, particulièrement vive, bien dégagée d'excreta. En la mettant à part, en lui assurant des aliments délicats qui conviennent à son jeune âge, nous la verrons grandir, se montrer capable peu à peu d'assimiler les aliments plus grossiers et jusqu'à des troncs d'arbre. Elle assimile, en effet, puisqu'elle rend semblable à elle-même, puisqu'elle change en feu les aliments convenables que lui fournit le milieu extérieur. Elle assimile, elle excrète et l'on peut intégralement lui appliquer l'équation de Le Dantec. Ce qui revient à dire avec plus de bonhomie : un peu plus de bois égale beaucoup de feu, plus de cendres, de la fumée et diverses substances de rebut.
Cette faiblesse n'est d'ailleurs pas la seule de la théorie mécaniste. A travers toutes les assertions savantes ou ingénieuses, on ne cesse pas un seul instant de voir la cellule orienter son travail vers un but précis. On dirait qu'elle fait effort pour prolonger le plus possible ses manifestations biologiques.
Mais ne voit-on pas alors apparaître le principe encombrant de finalité dont Le Dantec se défend énergiquement comme étant en contradiction avec toute son œuvre ? Et cependant comment concevoir ce singulier édifice qui s'écroule en partie aussitôt construit et se réédifie inlassablement en choisissant parmi beaucoup d'autres ses matériaux de construction ? En dehors de toute intervention étrangère, comment expliquer ce rythme alternant, condition de la santé, déterminant les phénomènes inverses de la désassimilation et de l'assimilation ?
Ce qui est plus grave encore, c'est que certains faits et non des moindres s'inscrivent contre cette théorie qui fait de l'assimilation le critérium exclusif de la Vie. Une certaine catégorie de cellules, fortes d'une tradition plusieurs fois millénaire, refusent obstinément toute nourriture, fussent-elles plongées dans un océan de liquides nourriciers. Ce sont les cellules sexuelles qui préfèrent périr misérablement plutôt qu'assimiler. Cet acte fortifierait la théorie chimique ; la cellule sexuelle non complétée par la cellule amie se refuse à l'accomplir et son existence, comme on sait, dépend d'une heureuse rencontre, souvent imprévue.
Les mécanistes ont assurément pensé à l'objection et ne pouvant chasser ces cellules du nombre des vivants, ils ont alourdi leur doctrine d'une conception hypothétique sur laquelle nous reviendrons au cours de cette étude.
En somme la théorie de Le Dantec est un effort remarquable vers la connaissance de la vérité. Quel que soit le respect que nous inspirent encore les noms illustres de Bichat, de Cuvier et même de Cl. Bernard, il est certain que leurs "forces directives" ne nous suffisent plus. Le médecin en particulier, comme conséquence de son éducation, trouve de vifs attraits à la théorie mécaniste. Cependant il lui reste un peu de ce penchant qui poussait les stoïciens à considérer la matière comme un "assemblage de forces".
Or, c'est précisément ce terme de force que les adeptes de la cinétique ont proscrit comme entaché de téléologie.
Nous ne pouvons pas nous résigner à le supprimer en Biologie sous le prétexte que nous ne percevons pas la force en elle-même et que nous n'en voyons que l'effet.
Quand deux lutteurs, épaule contre épaule, gardent l'immobilité de deux forces qui s'annulent, nous savons bien que leurs muscles travaillent dans une sorte de mouvement sur place dont les deux adversaires ont bien conscience.
Quoique non apparent ce double effort est efficace et si nous n'avions les moyens de mesurer le dégagement de chaleur fourni par les muscles en travail, la théorie obligerait contre le bon sens les mécanistes à nier ces deux forces qui se neutralisent.
Montrez à ces réalistes outranciers un bloc de marbre non dégrossi et une statue aux formes harmonieuses. Pour être d'accord avec leur système, pourquoi ne regarderaient-ils pas la pierre informe et l'œuvre d'art comme essentiellement, c'est-à-dire chimiquement identique ? N'est-ce pas dans les deux cas de l'acide carbonique uni à de la chaux dans les mêmes proportions ?... C'est ainsi que les arbres continuent à nous masquer la forêt.
Si l'on considère les réactions qui s'établissent entre la substance vivante et le milieu extérieur, on voit bien que ces réactions obéissent aux lois de la chimie des corps bruts. Mais parce qu'on a vu les phénomènes vitaux évoluer dans le cadre de la chimie, ne s'est-on pas un peu trop pressé de les cataloguer ? En les dissociant, en les considérant isolément, indépendamment les uns des autres, ne les a-t-on pas rapprochés avec trop de complaisance des phénomènes chimiques ordinaires, et en soulignant les ressemblances pour rejeter dans l'ombre les caractères différentiels, n'a-t-on pas plus ou moins volontairement poussé l'esprit à regarder comme identiques deux ordres de phénomènes très différents ?
"Puisqu'il y a une Biologie, dit Grasset non sans malice, il faut bien qu'il y ait des phénomènes biologiques."
Etudier les phénomènes vitaux après les avoir morcelés, analyser une "micelle" sans trop se préoccuper de sa voisine, regarder un composé comme la somme arithmétique de ses composants tels les mathématiciens qui considèrent le nombre comme la somme exacte de toutes les unités qu'il contient, c'est là une méthode séduisante pour des esprits nourris de certitudes scientifiques. Mais réfléchissons que cette certitude est une illusion et que l'analyse chimique quel que soit son perfectionnement ne nous a pas conduits encore, il s'en faut, jusqu'aux éléments simples d'un phénomène. Avec la chimie, nous connaissons un fragment de vérité. Pourrions-nous prétendre que nous n'ignorons rien d'un mécanisme compliqué si nous savions seulement que ce mécanisme est fait d'acier, de bois et de caoutchouc ? Il nous faut donc aller plus loin si nous voulons seulement approcher de l'essence des choses.
La théorie énergétique paraît mieux s'adapter à la complexité des phénomènes que les exagérations analytiques des mécanistes avaient par trop simplifiés. La notion de force forme la base solide de la Doctrine. Il ne s'agit pas, bien entendu, d'une notion anthropomorphique suggérée à l'esprit par le rapprochement d'une force mécanique avec l'effort musculaire que nous déployons à l'occasion d'un mouvement. C'est bien encore une représentation abstraite, un antécédent nécessaire, mais à l'inverse des cinétistes, les énergétistes estiment que ce mystérieux agent nous rend trop de services dans l'interprétation des faits pour qu'il nous soit possible de nous en passer.
Ce qui est certain, c'est que sous la diversité des phénomènes physiques, chimiques, mécaniques, etc., quelque chose demeure invariable. Cette constante, cet agent permanent et vivace qui peut bien revêtir des costumes variés mais qui se retrouve toujours comparable à lui-même, c'est l'Energie. Elle a beau, cette Energie, se présenter sous des formes et des allures différentes, nous la reconnaissons partout sans peine et la démasquons avec la plus grande facilité sans nous en laisser imposer par ses diverses formes.
D'ailleurs, sous un "manteau" ou sous un autre, cette fée mystérieuse se glisse partout, car elle est "la liaison des phénomènes". La voici dans ce foyer : c'est de l'énergie chimique ; dans cette chaudière : c'est de l'énergie thermique ; dans ce piston : c'est de l'énergie mécanique ; dans ce moteur : c'est de l'énergie électrique. Elle est le mouvement, elle est aussi le repos, car la voici prisonnière de ce morceau de charbon sous la forme d'énergie potentielle.
Indestructible et éternelle, cette énergie malheureusement pour nous se dégrade. Avec de l'électricité, vous obtiendrez sans peine de la chaleur, mais avec de la chaleur, vous n'aurez de l'énergie électrique qu'au prix d'une dissipation toujours croissante de l'énergie calorique, de sorte que si la provision de combustible ne se renouvelle pas pour entretenir les dénivellations énergétiques, vous vous trouverez très vite devant une forme d'énergie intransformable : l'énergie thermique. La chaleur est l'état inférieur dans lequel se complaît le mouvement et nous devons déplorer cette dépravation, car l'univers court à sa mort, par suite d'un équilibre thermique universel, sans qu'il nous soit possible d'y remédier.
Conservation de l'énergie, tendance à sa dégradation, voilà les deux grands principes de l'Energétique ; toutes les autres vérités fondamentales de la Mécanique en dérivent.
Mais qu'est-ce donc que cette Energie sans laquelle l'univers ne serait pas ? C'est un travail ou tout au moins une possibilité de travail. C'est une force multipliée par un espace ; c'est à la fois un poids et un volume et vous voyez bien que cette conception de l'énergie relègue la matière au rang des accessoires, puisque celle-ci n'existe que par l'énergie accumulée en elle. La matière vivante elle-même n'est pas autre chose. A vrai dire, il s'agit ici d'une forme spéciale de l'énergie encore mal connue dans ses modalités mais tenons pour assuré que ces énergies vitales ne diffèrent pas plus des énergies ordinaires que celles-ci ne diffèrent entre elles. Les principes ce Carnot et de Mayer sont applicables aux êtres vivants et si quelque chose distingue les phénomènes biologiques des autres phénomènes, c'est la faiblesse apparente de leurs manifestations. Dans leur succession continue, les énergies vitales dissimulées dans la profondeur des tissus se placent invariablement entre un phénomène chimique, antécédent nécessaire, et un phénomène électrique, lumineux ou le plus souvent thermique. L'ordre inverse ne se réalise jamais ; l'irréversibilité est absolue.
"Cette énergie vitale, dit Dastre, dans son beau livre sur la Vie et la Mort, cette énergie vitale emprunte au monde extérieur toute l'énergie qu'elle met en œuvre, et elle la lui emprunte sous forme d'énergie chimique."
C'est précisément cette énergie chimique qui se détruit pendant les manifestations fonctionnelles dont l'intermittence permet à l'organisme de réparer les pertes par des assimilations profondes et discrètes.
Les animaux apparaissent ainsi comme des dissipateurs de l'énergie chimique de haute noblesse en faveur d'une énergie thermique dégradée ; mais par suite d'une heureuse compensation, le règne végétal rétablit l'équilibre ainsi compromis. Grâce à l'énergie solaire, les plantes fabriquent des produits synthétiques variés qui deviennent plus tard les réserves chimiques des animaux. C'est de cette façon qu'un échange continuel de services entre les trois règnes de la Nature permet à la matière de fermer le cycle de ses transformations, et aux formes vivantes de continuer leur évolution.
Tels sont les principes fondamentaux de cette science de l'Energie que j'ai résumés aussi brièvement que possible. Il est incontestable qu'ils ne suffisent pas à expliquer l'univers, mais quelle doctrine réalisera ce prodige ?
L'opposition entre la stabilité, l'invariabilité de l'énergie dans son essence et la mutabilité de ses formes reste une notion capitale, selon nous. La dégradation de l'énergie, imposant une direction aux mouvements qui régissent les phénomènes est un principe de la plus haute portée philosophique, car il pourrait bien tendre à résoudre non par l'intuition, mais par l'expérience le problème de la finalité. Enfin l'irréversibilité de cette énergie dégradée souligne à la fois l'impossibilité d'un retour au passé et la fuite irréparable du Temps. La grande idée d'évolution domine toute la doctrine et la vivifie.
Mais pourquoi faut-il regretter que la crainte de certaines spéculations non immédiatement contrôlables ait immobilisé les partisans de cette doctrine au milieu de leur route ? Ils ont été arrêtés par un scrupule scientifique qui donne la mesure de leur prudente sagesse, mais qui enlève à la doctrine son caractère d'universalité.
Aux yeux des Energétistes le Temps continue à encadrer les phénomènes sans avoir aucune action sur eux. C'est un épiphénomène, un fantôme qui accompagne tous les mouvements, toutes les transformations de l'énergie, mais ne joue aucun rôle dans la détermination de ces changements. Cependant succession et changement sont deux termes inséparables dans la réalité. L'esprit de l'homme les sépare par un effort d'abstraction, et les partisans de l'Energétique ne reculent pas devant une abstraction. Ainsi la notion mécanique de force, bien que forcément abstraite ne leur inspire aucune inquiétude ; mais ils se défient à tel point de leur imagination qu'ils ne se risquent pas à regarder cette force comme une cause de mouvement, mais qu'ils jugent plus prudent de la considérer comme un simple antécédent.
Moins timides philosophiquement, ils auraient peut-être été en mesure d'analyser de plus près les éléments de l'énergie, cause actuelle des phénomènes. Peut-être auraient-ils remarqué aussi que les grandes lois du progrès et de l'hérédité ne sont pas applicables à la seule matière organisée, que l 'évolution entraîne dans sa marche irrésistible non seulement les êtres, mais les choses, que le déterminisme scientifique est dominé par la loi de relativité, que par voie de conséquence ce même déterminisme n'est prévisible que dans ses grandes lignes, car la même cause ne se retrouve pas deux fois identique et que l'univers tout entier pourrait bien être, suivant une vieille conception panthéiste, le fait d'une création répétée de tous les instants. Ils n'auraient sans doute pas davantage abouti à cette conclusion hasardée d'une fin déterminée par un équilibre thermique universel, et, ils auraient peut-être bien prévu l'évanouissement ce cette matière, tout aussi bien que de cette énergie qu'ils déclaraient impérissables.
La Vie à son tour leur serait apparue comme la période la plus avancée d'une évolution qui se précipite de plus en plus vite. Le dualisme sexuel contemporain de la maladie, exaltation du dualisme pathologique par excès aurait pris à leurs yeux la signification du dualisme cosmogonique : la force pure et le mouvement pur synthétisés dans l'énergie. De cette même énergie réputée inaltérable, ils en auraient fait sans difficulté le sacrifice à la Pensée pure, la seule énergie privée d'inertie, mouvement de vitesse infinie et par conséquent sans détermination, sans direction, remplissant l'Espace, mais par suite, échappant à l'Etendue et au Temps, n'ayant enfin aucune action directe, je ne dis pas médiate, sur la matière.
On devine que c'est vers cette conclusion que va s'orienter notre thèse qui n'est qu'une page de la doctrine énergétique amplifiée. Dans notre esprit, le Temps et la Force, l'Etendue et le Mouvement, l'Espace et la Pensée sont des termes équivalents deux à deux. Ces trois couples n'ont pas d'existence indépendante et sont plus étroitement liés entre eux que la source d'un fleuve l'est à la mer par l'écoulement continu du cours d'eau. Le Temps devient alors la cause réelle de l'évolution, l'Etendue en est comme l'expression perceptible, et l'Espace l'aboutissant.
L'état présent qui est un éclair représente bien le travail accompli par toute la série des phénomènes passés, et ce terme de travail prend bien ici le sens que les énergétistes lui donnent : c'est le produit d'une force par un espace parcouru.
La durée est bien une force. "C'est le progrès continu du passé qui gonfle en s'avançant" (Bergson), et c'est évidemment la seule force qui puisse nous expliquer l'univers actuel. Sa pesée de plus en plus formidable a pour effet d'accroître sans répit la vitesse de l'évolution, si bien que la Science, si elle en était arrivée à sa conclusion, pourrait définir le moment actuel par la formule 1/2.mv², c'est-à-dire par une force vive.
Or, remarquez que cette formule nous présente une masse et une vitesse que nous serions tentés de traduire par ces deux autres termes : une force et un mouvement. Nous reconnaissons volontiers que cette force est la cause du mouvement, mais nous savons bien aussi que ce mouvement est autre chose que la force. A l'instant où j'écris, le mouvement de ma main, mouvement de vitesse finie, deviendrait infini et dépasserait Ain les limites de l'Etendue, si la matière ou pour être plus précis, la durée qui est à la fois un moteur et un frein, ne tendait à ralentir ce mouvement, à le capter, tout en le produisant. L'évanouissement total de la matière et par suite de l'énergie introduira dans la série d'actions et de réactions qui font l'univers un déséquilibre qui ne peut aller qu'en s'accentuant. Le mouvement va grandissant de vitesse à mesure que la matière qui est à la fois la cause du mouvement et son obstacle diminue en quantité.
Tout phénomène comportera donc l'étude de deux éléments indispensables, la force et le mouvement, ce dernier toujours entaché d'inertie, sauf dans le phénomène psychologique pur, qui est encore à réaliser.
La première partie de cet ouvrage présentera au lecteur l'interprétation que nous croyons pouvoir donner de la matière, des phénomènes et des Radiations, parmi lesquelles nous réserverons une place importante aux radiations biologiques, vers lesquelles tend l'univers entier.
La Vie est une étape de l'évolution caractérisée par la vitesse et la continuité de faibles réactions chimiques. Ce résultat est obtenu grâce à l'apparition progressive des catalyseurs qui mettront un trait d'union entre le phénomène physico-chimique et le phénomène biologique.
Nous passerons ainsi naturellement à la deuxième partie. Le catalyseur le plus remarquable est la cellule sexuelle mâle ; la matière la plus sujette à variation est la cellule sexuelle femelle. L'union des deux éléments réalisera la matière vivante qui n'est qu'un état particulier de la matière inerte adaptée à l'accélération des phénomènes.
Qu'il s'agisse d'un être ou d'une chose, l'existence est un travail défini à chaque instant par le produit d'une force et d'un espace parcouru. Mais alors que la matière inerte conserve surtout son énergie sous forme de potentiel, la matière vivante plus avancée dans le temps, c'est-à-dire plus jeune, plus tard venue, réalise en grande partie la sienne sous forme de mouvement. L'accélération sera la condition du progrès, c'est-à-dire de la différenciation.
Nous aurons surtout à étudier le rôle de la sexualité et de la maladie, son expression la plus atténuée, dans la détermination de cette accélération dont la tachygénèse nous fournira une preuve concrète.
Si nous supposons qu'un cerveau organisé soit capable de faire prendre aux phénomènes une vitesse tendant vers l'infini, le phénomène biologique tendra vers le phénomène psychologique. Enfin, quand tout l'univers aura gagné cette vitesse infinie, le Temps aura fondu dans l'Espace.
La Vie nous apparaîtra alors clairement comme l'intermédiaire nécessaire entre le mouvement mesurable de tout corps matériel et le mouvement incommensurable de la Pensée, libérée de tout obstacle.
Nous nous excusons d'avoir ainsi sans grande précaution, jeté le lecteur au travers d'une conception métaphysique de l'univers. Nous espérons toutefois au cours de ce travail retrancher de la discussion, toutes les fois qu'il sera possible, les raisons purement théoriques pour les remplacer par des faits concrets.
Qu'on ne s'y trompe pas si nous proposons ici non une méthode, mais un système, ce sera un système sans dogmatisme débarrassé de toute ruse de guerre destinée à jeter un masque sur l'inanité ou la faiblesse d'un argument. Notre seule ambition est, comme dit Montaigne "qu'en retastant et pétrissant cette matière, en la remuant et en l'eschauffant, nous ouvrions à celui qui nous suit quelque facilité pour en jouir plus à son aise."
Il faudrait, à vrai dire, pour accomplir dignement ce programme avoir au moins effleuré une bonne partie de l'énorme somme de connaissances acquises aujourd'hui. Il serait ingénu d'ajouter que nous nous trouvons fort en deçà d'une telle préparation. Aussi devons-nous solliciter l'indulgence du lecteur qui prendra en pitié un effort si éloigné du but.
Quand on est aussi mal armé que nous le sommes en face d'un si grand dessein, "on prend le visage de l'assurance par contenance". On compte sur l'intérêt qui s'attache au sujet et non à œuvre pour faire oublier la folie d'une entreprise aussi légèrement risquée.
Si nous trébuchons aux premiers pas, l'accident tout personnel sera sans importance et passera inaperçu ; mais si par aventure il en était autrement, et si semblables à ces croix élevées sur les lieux d'un sinistre pour signaler un danger, plus encore que pour commémorer une obscure victime, le souvenir de notre chute pouvait en éviter d'autres, nous nous féliciterions de notre malheur et nous en tirerions une légitime fierté.